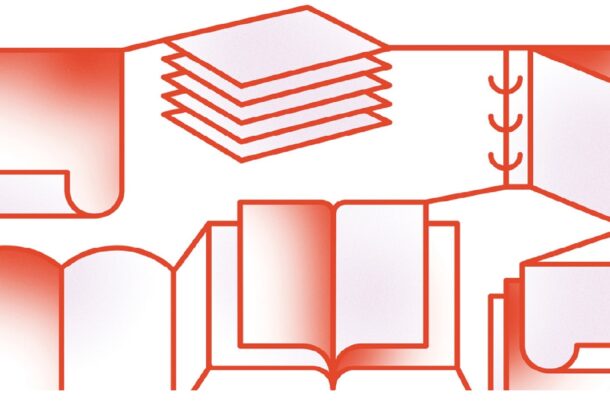Expositions
DU CARE À L’OUVRAGE
Commissaire(s): Andrea Oberhuber, Sofiane Laghouati
« Qu’est-ce que le care ? C’est d’abord un objet qui éclaire autrement les problèmes politiques et éthiques de la vulnérabilité, de la dépendance et de l’autonomie. C’est ensuite une méthode qui construit un regard sensible et raisonné pour appréhender différemment les formes sociales de la relation humaine dans le monde de la vie morale, politique et esthétique. »
Fabienne Brugère et Claude Gautier, dans Estelle Ferrarese, La fragilité du souci des autres, 2018.

Le care a partie liée avec le corps auquel il s’agit de prodiguer des soins, mais il implique au même titre la psyché avec laquelle il forme une entité duelle. Prendre soin de l’autre n’est pas simplement synonyme de bienveillance, ni de don ou de sacrifice de soi. Il y a de nombreux lieux communs associés à ce qu’on désigne en anglais par le terme « care » qui est à l’origine de l’éthique du care fondée en 1982 par Carol Gilligan dans In a Different Voice.
Polysémique et au cœur des études sur le care des deux côtés de l’Atlantique dans diverses disciplines des sciences humaines, le care englobe autant l’attitude de sollicitude que les activités et les pratiques du care giving (soin matériel) effectuées par des infirmier.ères, des aide-soignant.es et des médecins, des parents ou des nounous, des domestiques en tout genre (femme de chambre ou de ménage, cuisinière et cuisinier, majordome, etc.) et des enseignant.es, entre autres, idéalement dans une relation de symétrie et non de verticalité.
L’exposition est issue du séminaire « Écrits des femmes (XIXe – XXIe siècles) » proposé par Andrea Oberhuber au trimestre d’hiver 2023 à l’Université de Montréal. C’est dans une perspective croisée entre des conceptions du care dans la première moitié du XXe siècle et l’époque contemporaine qu’ont été pensées les modalités du « prendre soin de l’autre » (care giving) en littérature.
Il y a bien sûr des figures ambivalentes qui prennent soin comme l’infirmière, la médecin, la mère criminelle, la nounou (meurtrière), la fille accompagnatrice et l’enseignante pour tenir compte du corpus à l’étude. Et il y a celles qui reçoivent des soins (care receiving) à l’instar des malades à la maison, des patient.es à l’hôpital ou en milieu psychiatrique. En accordant une grande importance à divers objets symboliques, les œuvres qui sont données à voir se montrent attentives au (dys)fonctionnement de la dynamique ainsi que des jeux de pouvoir qui régissent toute relation de care. Ce sont les étudiant.es du séminaire qui ont conçu les différents contenus de l’exposition en tâchant de penser avec des objets la manière dont le « care » traverse les œuvres choisies.
D’un contenu-objet à l’autre, on comprend qu’un acte de sollicitude ou de soin (matériel) contient en soi sa charge d’ambivalence : tantôt il peut contribuer à « réparer les vivants », pour reprendre le titre d’un roman de Maylis de Kerangal ; tantôt il se retourne en son contraire, comme dans les cas de surveillance et d’enfermement psychiatrique, d’infanticide, de transmission d’un vécu traumatique, de déni d’une maladie, ou encore d’un trop-plein d’empathie. En ce sens, le care et ses travers (prenant la forme d’un anti-care) peuvent se disputer la parole au sein d’une même œuvre littéraire, nous invitant alors à une compréhension nuancée des pratiques attentionnelles et de leurs mises en œuvre.
Crédits :
Commissariat général : Sofiane Laghouati (Musée royal de Mariemont/UCL) et Andrea Oberhuber (Université de Montréal) .
Commissariat des « contenus-objets » : Juliette Bouchard-Lussier, Éléonore Caron, Myrtia Gehin, Sarah Groulx, Andrea Oberhuber, Kenza Sib et Xin Tan.
Collaboratrices : Caroline Hogue et Pascale Joubi
Œuvres exposées :
Marcelle Tinayre (L’Ombre de l’amour, 1909), Simone de Beauvoir (Une mort très douce, 1964) Annie Ernaux (« Je ne suis pas sortie de ma nuit », 1997), Marie-Célie Agnant (Le Livre d’Emma, 2001), Ouanessa Younsi (Soigner, aimer, 2012), Élise Turcotte (Le Parfum de la tubéreuse, 2015) et Victoria Mas (Le Bal des folles, 2019).